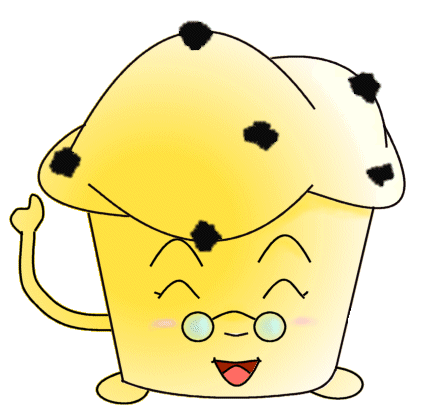|
Initiation | Articles de presse |
|
* Le Yaoi Les japonaises n’ont jamais été de gentilles filles sages ! Mineurs et prudes s’abstenir, surtout quand nippon rime avec fripon. « Sans point culminant, sans chute, sans intrigue » ou encore « Arrête, j’ai mal au c… ! ». Cela ne veut peut-être rien dire pour vous, mais chez les initiés se dessine déjà, devant leurs yeux avides, l’acronyme YAOI. Cette forme de Shôjo fait son apparition au milieu des années 1970 avec des mangaka comme Keiko Takemiya (Kaze to ki no uta) ou Moto Hagio (Toma no shinzo) qui, subjuguées par des manga comme Princesse Saphir de Osamu Tezuka, décident d’assouvir les désirs de leurs congénères : voir l’amitié de beaux garçons évoluer et plus si affinités. Parallèlement, le marché du Dojinshi se développe, inondant les conventions d’histoires d’amours dérivées de Shônen ou Seinen populaire. Aucune série n’est épargnée et les œuvres cultes (Olive et Tom, Les chevaliers du Zodiaques…) ont toujours autant d’impact, même si aujourd’hui, Sasuke et Naruto remportent tous les suffrages. Pour ceux qui n’auraient toujours rien compris, ce genre de manga, d’anime ou de romans relatent des relations homosexuelles, et sont généralement émaillées de scène sexuellement explicites. Les mots pour le dire Les deux protagonistes d cette relation amoureuse et charnelle portent eux aussi des noms bien codifiés. Ainsi, le stéréotype du mâle viril, puissant, plus âgé et protecteur sera le seme, dérivé du verbe « semeru » (attaquer). L’autre protagoniste, le uke, du verbe « ukeru » (recevoir), aura souvent une apparence androgyne, pour ne pas dire ambiguë. Le uke est donc aussi efféminé que le seme est masculin. Le Boy’s love, qu’il soit amateur (dojinshi), innocent (shonen-ai), pervers (shota) ou érotique (yaoi), est dessiné par des femmes pour un public féminin. Les auteurs s’échinent à dessiner ces histoires entre deux hommes, avec leurs propres expériences comme références. Autant dire que question réalisme et véracité, ces mangas reposent souvent sur du vent. C’en est parfois à se demander si elles ont déjà aperçu un spécimen du sexe opposé, tant certains personnages paraissent irréels.
Carla Cino pour Animeland Hors Série n°13 de Juin-juillet 2007 |
|
* Vous voulez apprendre le japonais ? Vous avez mangé quelques fois au restaurant japonais, vu des animes, reçu un correspondant, et vous avez eu une copine japonaise. Et maintenant, quelque part au fond de votre tout petit cerveau, vous vous dites que le japonais serait une bonne langue à apprendre. Hé, vous pourriez traduire des jeux vidéo ! Ou des mangas ! Ou même des anime ! Vous faire des japonaises, impressionner vos amis ! Peut-être même aller au Japon et devenir un dessinateur de manga ! Ouais ! Ca a l'air d'une super idée ! Donc vous vous dirigez vers la bibliothèque, vous choisissez des livres du genre " Comment apprendre tout seul le japonais en seulement 5 secondes par jour en conduisant jusqu'au bureau de poste " et " Le japonais pour les abrutis complets et irrécupérables qui ne devraient jamais se reproduire". Hé, vous connaissez déjà quelques mots grâce à votre collection de manga/d'anime/copine. Excité et impressionné par vos nouvelles connaissances, vous commencez à vous dire : " Hey, peut-être, peut-être que je pourrais en faire mon métier ! Ou même être diplômé de japonais ! Super idée, non ? NON ! Je me fous du nombre du nombre de vidéos d'anime que vous avez vues, du nombre de Japonaises avec qui vous êtes sorti, ou des livres que vous avez lus, vous ne parlez pas japonais. Non seulement ça, mais en plus avoir un diplôme dans cette langue de merde n'est PAS DU TOUT amusant, ni même prudent. Les prisonniers de guerre irakiens sont souvent contraints d'apprendre le japonais. Le terme 'holocauste' vient de deux racines latines, 'Holi' et 'Causm', qui signifient respectivement 'apprendre' et 'le japonais'. Vous avez saisi. Et donc, écoeuré de voir tant de moutons courir gaiement à l'abattoir, j'ai créé ce guide contenant de VRAIS TRUCS pour apprendre le japonais. Ou plutôt, pour NE PAS l'apprendre !! Raison un : C'est trop dur ! Ca devrait être évident. Malgré ce que de nombreux manuels, amis, ou cours en ligne ont pu vous dire, le japonais n'est PAS simple, facile, ou même logique (le vocabulaire japonais est déterminé en lançant de petits morceaux de sushi sur une cible où des syllabes sont écrites aléatoirement). Les Japonais répandent ces rumeurs pour attirer les Gaijin imprudents dans leurs pièges. Ce n'est pas seulement que ce n'est pas facile, c'est probablement l'une des langues les plus difficiles que l'on puisse apprendre. Avec TROIS alphabets totalement différents (aucun n'ayant le moindre sens), de multiple niveaux de politesse inutiles, et une structure grammaticale totalement aberrante, le japonais torture l'esprit de Gaijin pathétiques depuis sa création. Passons en revue certains des éléments mentionnées ci-dessus pour que vous ayez une meilleure idée de ce que je veux dire. Le système d'écriture japonais Le système d'écriture japonais est séparé en trois parties autonomes, sans la moindre logique : Hiragana ("Les petites lettres tordues"), Katakana ("Les petites lettres carrées"), et Kanji ("Les 4 millions d'incarnations de vos pires cauchemars"). Les Hiragana servent à écrire les mots japonais de manière phonétique. Ils sont nombreux, tous totalement différents, sans aucune ressemblance entre eux. Les Hiragana ont été créés en demandant à des japonais aveugles, sourds, et stupides de gribouiller sur des petits bouts de papier, sans qu'ils aient la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Le résultat a été appelé Hiragana. Le prince qui a inventé ce système, Yorimushi (" âne-petit arbre-singe puant ") fut rapidement exécuté. Mais ne vous en faites pas, vous aurez rarement à utiliser des Hiragana dans la 'vie réelle'. Les Katakana servent à transcrire les mots étrangers, avec un accent japonais à couper au couteau, si bien que vous n'aurez aucune idée de ce que vous pouvez bien raconter, même si c'est en anglais. Pourtant, si vous vous souvenez d'une règle simple pour les Katakana, vous trouverez la lecture du japonais bien plus facile : chaque fois que quelque chose est écrit en Katakana, c'est un mot anglais ! [Note : les Katakana sont aussi employés pour les mots étrangers non-anglais. Et les onomatopées, et des mots japonais.] Les Katakana se ressemblent tous, et il est impossible, même pour les Japonais, de les différencier. Ne vous en faites pas, parce que vous n'aurez que rarement besoin de lire des mots en Katakana dans la 'vie réelle'. Les Kanji sont des caractères volés aux Chinois. Chaque fois que les Japonais envahissaient la Chine (et ça arrivait souvent), ils emportaient de nouveaux caractères, du coup on estime désormais leur nombre à 400 trilliards. Les Kanji sont fait de plusieurs 'traits', qui doivent être tracés dans un ordre spécifique, et ils transmettent un sens, comme 'cheval' ou 'fille'. Mais encore, les Kanji peuvent être combinés pour faire de nouveaux mots. Par exemple, si vous combinez le Kanji de 'petit' et celui de 'femme', vous obtenez le mot 'carburateur'. Les kanji ont également des prononciations qui changent selon leur place dans la phrase, votre âge, et le jour de la semaine. Quand les premiers voyageurs européens arrivèrent au Japon, les savants japonais émirent l'idée que l'Europe adopte le japonais comme langue universelle, comprise par tous. C'est ce qui a finalement causé la deuxième Guerre Mondiale, quelques années plus tard. Pourtant, ne vous inquiétez pas, puisque vous n'aurez jamais à utiliser les kanji dans la 'vie réelle' : la plupart des Japonais ont arrêté de lire il y a très longtemps, désormais ils consacrent la plus grande partie de leur temps à jouer aux Pokémons. Les niveaux de politesse L'origine des niveaux de politesse se situe dans l'antique tradition japonaise d'obéissance et de conformité absolue, de castes sociales, et de respect total pour l'arbitraire de l'autorité hiérarchique, ce que de nombreuses compagnies américaines trouvent très efficace une fois appliqué au management. Bien sûr, ils ont raison, mais personne ne s'en trouve vraiment ravi. Suivant à qui vous vous adresserez, votre degré de politesse sera très différent. La politesse dépend de beaucoup de choses, comme l'âge de celui qui parle, l'âge de celui à qui on parle, l'heure de la journée, les signes zodiacaux, les groupes sanguins, le sexe, le type de Pokémon, la couleur des pantalons, et ainsi de suite. Pour un exemple des niveaux de politesse en action, voyez l'exemple ci-dessous : - Prof japonais : ' Bonjour, Harry.' - Harry : ' Bonjour.' - Etudiants japonais: [cris étranglés d'horreur] La conclusion, c'est que les niveaux de politesse sont bien au-delà de votre champ de compréhension, donc n'essayez même pas. Résignez-vous simplement à parler comme une petite fille jusqu'à la fin de votre vie, en espérant que personne ne vous frappe. Structure grammaticale Les Japonais ont ce qu'on pourrait appeler une syntaxe 'intéressante', mais on pourrait aussi bien dire qu'elle est 'incompréhensible', 'aléatoire', 'merdique', ou 'maléfique'. Pour bien comprendre, examinons les différences entre les syntaxes japonaises et françaises. Phrase française : Jane va à l'école. Même phrase en japonais : Ecole Jane à aller singe pomme carburateur. La grammaire japonaise n'est pas faite pour les peureux ou pour les faibles d'esprit. En plus, les Japonais n'ont pas de mots pour dire 'moi', 'eux', 'lui', ou 'elle' qu'on puisse utiliser sans être effroyablement insultant (le mot japonais pour dire 'tu', par exemple, s'écrit avec un kanji qui signifie 'j'espère qu'un singe va t'arracher la tête'). Du coup, les phrases 'Il l'a tué !' et 'Je l'ai tué !' se disent exactement de la même manière, ce qui veut dire que la plupart des gens au Japon n'ont aucune idée de ce qui se passe exactement autour d'eux, à aucun moment. Vous êtes censé déduire ce genre de choses du 'contexte', qui est un mot allemand qui signifie 'vous êtes niqué'. Raison deux : Les Japonais Quand on pense aux Japonais, on pense : poli, respectueux, accommodant. (Certains pensent aussi Chinois). Pourtant, il est bon de savoir où s'arrête la vérité et où commence le stéréotype occidental. Bien sûr, je serais totalement irresponsable de faire des généralisations abusives à propos d'un si grand nombre de gens, mais TOUS les Japonais ont ces trois caractéristiques : ils 'parlent' anglais, ils s'habillent très bien, et ils sont petits. Le système scolaire japonais est contrôlé par le gouvernement japonais, qui est, bien entendu, parfaitement objectif (les livres d'histoire contemporaine ont des titres comme: 'Les démons blancs essayent de voler notre sainte patrie, mais le grand et puissant empereur-patriarche les écrase grâce aux vents de Dieu : une histoire de la deuxième Guerre Mondiale'). C'est pourquoi tous les japonais ont eu le même cours d'anglais, qui consiste à lire les Contes de Canterbury, à regarder quelques épisodes de M*A*S*H, et à lire un dictionnaire anglais d'un bout à l'autre. Armés de ces connaissances linguistiques démesurées, les enfants du Japon sortent de l'école prêt à prendre part au commerce international, prononçant des phrases aussi remarquables et mémorables que 'Vous n'avez aucune chance de survie faites votre temps' ; ils choisissent aussi des slogans anglais pour leurs produits, comme 'Tentez votre Paul. Ca pourrait être le Paul de votre vie'. Deuxièmement, tous les Japonais s'habillent très bien. Cela s'accorde très bien avec l'attitude générale de netteté et d'ordre. Tout doit être à la bonne place avec les Japonais, ou une petite partie du lobe droit de leur cerveau est prise d'apoplexie et ils ont un comportement violent jusqu'à ce que le désordre soit éradiqué. Les Japonais PLIENT LEUR LINGE SALE. La négligence n'est pas tolérée dans la société japonaise, et ceux qui pensaient pouvoir camoufler une chemise un peu froissée sous un sweat à capuche sont rapidement lapidés avec de minuscules téléphones portables. Enfin, les Japonais sont tous petits. Mais vraiment petits. C'est assez drôle. N'étant pas non plus du genre à laisser le privilège d'être grand aux Européens ou aux Africains, les Japonais ont unilatéralement lancé la mode des chaussures avec des semelles démesurées, pour pouvoir sembler de taille humaine ; en réalité, leur taille suggère qu'ils appartiennent plutôt à la race des nains ou à celle des hobbits. La culture japonaise est aussi très 'intéressante', ce qui veut dire 'incompréhensible', et dans plusieurs cas 'dangereuse'. Leur culture est basée sur le concept 'dans le groupe / hors du groupe', avec tous les Japonais composant un gros groupe, vous laissant VOUS hors du groupe. En dehors de ce sentiment d'aliénation, le Japon produit aussi des bandes dessinées, et une large variété d'autres produits de consommation qui vous sont jetés à la figure 24h par jour, sept jours par semaine. Les Japonais aiment aussi les monstres qui vivent dans votre pantalon, prendre des bains avec les personnes âgées, et se suicider. La nourriture japonaise pourrait être qualifiée par certains d'exotique, mais la plupart des gens la qualifieraient de 'répugnante', ou même, dans certains endroits, de 'catastrophe naturelle'. La gastronomie japonaise date des temps anciens où la base de l'alimentation était le riz. Les gens furent finalement si écoeurés par le riz qu'ils finirent par manger n'importe quoi d'autre, comme par exemple des algues ou d'autres Japonais. C'est ce qui a permis la création de plats aussi merveilleux que le 'Natto', qui est je crois un genre de haricot, mais avec un goût d'acide nitrique, ou les 'Poki', qui sont des bâtons avec différents glaçages, dont les parfums vont de 'sciure' à 'fraise'. Malgré cette grande variété de nourriture, les Japonais ont réussi à donner à tout ce qu'ils mangent, du thé aux prunes, un goût de bœuf séché. Raison Trois : Les autres étudiants Comme si langue elle-même n'était pas assez difficile, les cours de japonais ont tendance à attirer le genre de gens qui vous fait souhaiter qu'une grosse comète percute la terre. Il y a un certain nombre d'étudiants de base que vous rencontrerez quoi qu'il arrive : le fan de manga, le Je-sais-tout, et la bête traquée. Le fan de manga est probablement le plus commun, et sans doute l'un des plus épuisants. Généralement, un certain nombre de symptômes vous permettent de l'identifier avant qu'il ne soit trop tard : il porte strictement le même T-shirt Evangelion tous les jours, il a au moins deux porte-clés manga sur lui, il porte des lunettes, il dit des phrases en japonais qu'il ne comprend visiblement pas ('Oui ! Je ne te pardonnerai jamais !'), il vous appelle '-san', il fait d'obscures références à la culture japonaise en cours, et généralement il rate ses examens. Vous devez être extrêmement prudent, et ne jamais le laisser deviner de la peur ou de la pitié en vous, car sinon il vous sautera immédiatement dessus, aspirant votre temps et votre patience, jusqu'à ce qu'il ne reste de vous qu'un corps sans vie. Prêt à tout pour un peu de chaleur humaine, il vous invitera à des meetings, à des expositions, et tout un tas d'autres choses dont vous vous moquez éperdument. Le Je-sais-tout de base a une copine japonaise, et du fait de sa 'source privilégiée' sur la culture japonaise, il est subitement devenu un expert sur tout ce qui vient du Japon, sans même avoir lu un seul livre sur le Japon de toute sa vie. On peut repérer le Je-sais-tout en guettant différents signaux d'alarme : un sourire satisfait, une tendance à répondre aux questions plus souvent qu'à son tour, la plupart de ses réponses étant fausses ; il interroge le prof sur divers sujets, puis conteste la réponse. Un dialogue classique : - Etudiant : 'Ca veut dire quoi, "ohaioo" ?' - Prof : 'Ca veut dire "Bonjour", le matin' - Etudiant : 'C'est pas ce que ma copine a dit…' Il se trompe beaucoup, parle beaucoup de cuisine japonaise, donne des réponses longues et détaillés sur des sujets inintéressants, en se trompant, et rate ses examens. La bête traquée est un étudiant qui fait du Japonais parce que a) ça avait l'air sympa, b) il pensait que ce serait facile, c) il ne lui manque plus que quelques points pour avoir son diplôme. Il porte un masque de terreur et de panique du moment où il rentre en cours à celui où il en part, car tout ce qu'il entend, c'est le hurlement de son futur englouti par une chasse d'eau. En général, il rate ses examens. Bien que de nombreux étudiants en Japonais soient intelligents, travailleurs, et plein d'humour, aucun d'entre eux ne sera dans votre classe. Conclusion Si vous survivez aux difficultés, à la société, et à vos camarades, vous découvrirez sans doute que le japonais est une langue agréable et intéressante à apprendre. Malheureusement, nous n'en savons rien, en effet personne n'est jamais allé aussi loin. Mais attention, je suis sûr que vous, vous êtes différent. Texte original : © Dan Barrett pour ninjanet |
|
* Les « fanfics », scénaristes amateurs en série. Les sorcières de « Charmed » en vacances chez « Buffy », Spock déclarant son homosexualité à la galaxie « Star Trek »…. Improbables ? A « sérievores » rien d’impossible, rétorque la communauté « fanfics ». Piqués d’écriture, ces fans de fictions prolongent sur Internet les scénarios de leurs séries cultes. « Le principe ? » Emmener l’histoire d’importe où, tant qu’on respecte l’univers de la série et le caractère des personnages », explique Phipille Grandfond, webmaster et créateur d’un des deus sites français spécialisés. (www.francofanfic.com) Cette pratique est née dans les années 1970, quand les fans de « Star Trek », anéantis par la disparition de leurs idoles aux grandes oreilles ont décidé d’assumer la survie de leur héros. Depuis, les « fanfics » se sont divisés en moult sous catégories. Erotique, fleur bleue, violent… « Les récits sont souvent durs et crus : ils révèlent les fantasmes d’auteurs, qui sont surtout des jeunes filles de 15-18ans », analyse Philippe Grandfond. Si la fanfiction » permet aux drogués de l’épisode de tenir le coup entre deux saisons ou de ne pas faire le deuil de programme défunts, elle est aussi une riposte à des scénarios jugés incohérents. « On ne trouvera pas sur le Net des personnages qui meurent subitement, parce que la prod a rétréci le budget ou que l’auteur s’est engueulé avec un acteur, rigole Plume Jade, auteure de récits d’ « Urgence ». J’essai d’être en phase avec la psychologie des personnages, en explorant leur parts d’ombre. » Travail d’écrivain ou imposture ? « Il est sain que les gens s’approprient cette culture populaire, soutient Martin Winckler, romancier et fan de séries. Les héros sont à tout le monde, et la création littéraire n’est pas l’apanage d’une élite. » La preuve par l’exemple : Mélissa Good, « fanfic » américaine passionnées de « Xéna, princesse guerrière », a été recrutée sur la série, la vraie. « Nous jouons tous aux petites scénaristes mais devenir pro, c’est autre chose », comment Lojie, 23ans, auteure d’écris amateurs dédiés à « Alias ». A l’instar de la tribu des « fanfics », elle nourrit des ambitions plus mesurées. Espérant juste que sa prose convaincra les auteurs d’ «Alias » de ne pas tuer son héroïne trop tôt. Christel Brigaudeau pour © 20 minutes - 27 Avril 2006 |
|
* Kiffeurs de Fics L’attente de la nouvelle saison de Lost vous semble insupportable ? Vous rêvez de connaître la vie cachée de Dumbledore ? Sur le net, des fans prennent la plume. « Luka, je suis enceinte… Plusieurs secondes s'écoulèrent avant qu'elle ne se sente le courage de le regarder à nouveau. Elle avait à présent trop peur de sa réaction, elle se disait qu'elle aurait sans doute mieux fait de ne rien lui dire, qu'il était trop tôt, qu'ils n'étaient pas prêts… Abby fit-il dans un souffle, c'est… Wouah, si je m'attendais à ça… c'est… merveilleux, c'est merveilleux… » Ne courez pas vous repasser l’intégrale d’Urgences : vous n’avez pas loupé cet épisode ! Cest sur le web que vous pourrez suivre l’accouchement de l’infirmière Lockart : persuadée que Luka et Abby sont un des meilleurs couples de sa série préférée, Aline, 18 ans, s’est offerte le plaisir d’une histoire qui finit en forme de poupon. Aline est une « fanfiqueuse », une des innombrables fans de série, qui a décidé d’écrire elle-même de nouveaux épisodes de ses héros en pyjamas verts, histoire de tromper l’ennui de ses longues semaines d’attente, entre deux soirées ou deux saisons façon « NFS, Chimie, Iono, gaz du sang… » Si les fans de Sherlock Holmes puis de Star Trek, n’ont pas attendu que les fils de la Toile se tissent pour accueillir leurs productions perso, le Net a conféré des dimensions planétaires à leur art : sur le site fanfiction.net/, des dizaines de milliers d'auteurs de tous pays retricotent à leur façon quelque 1.305 séries télé, romans, dessins animés, films, chansons, mangas... Et si les sites francophones n’ont pas encore l’ampleur de ce géant américain, francofanfic.com/ comptabilise plus de 15.000 visites mensuelles et accueille 5.000 fanfictions, issues des claviers d’un millier d'auteurs. Entre les aventures sado-masos de Buffy, les romances sur la plage de l’île des disparus de Lost, ou les aventures interstellaires des médecins du Cook County Hospital, le monde de la fanfic prend des allures de jungle ! Les fiqueurs « sérieux » respectent scrupuleusement le BA-ba de leur art : ils développent l’histoire de personnages secondaires, éclairent des zones d’ombre, continuent les aventures ou leur donnent un autre tournant pour calmer leurs frustrations, évitant soigneusement les incohérences avec l'œuvre originale et la psychologie des héros. Certains maîtrisent à ce point la scénographie, le rythme narratif et le langage de leur série préférée qu’ils arrivent à susciter chez leurs lecteurs le même sentiment d’impatience que celui qui les a poussés à écrire. Et c’est là que le mouvement s’emballe : la plupart des fiqueurs y sont venus en lisant. On en redemande, et puis on se lance. « Certains se jettent sur la nourriture, les fanfiqueurs, eux dévorent les fanfics » confie Dod, 21 ans, qui s’est lancée "à corps perdu" dans la fiction, pour assurer sa "ration quotidienne" de lecture tout en protégeant son portefeuille. Depuis son arrivée dans le monde des fanfics, Dod est devenue « bêta-lectrice » : une chasseuse de fautes d'orthographe et de grammaire, qui donne aussi un premier avis sur les fics de son amie Leena Asakura, 23 ans. Ensemble, la jeune diplômée en techniques de l’édition et l’étudiante en bio-informatique et bio-statistique ont fondé il y a un peu plus de deux ans, ombre-et-folie.com/, un « hôpital psychiatrique » pour les mordus d’Harry Potter.C’est souvent sur ce genre de sites, plutôt confidentiels mais initiés et animés par de vrais passionnés, que les amateurs voient récompensés de leur patience et leur persévérance à se frayer un chemin dans le foisonnement web de fics de qualités inégale. Kima, 21 ans, étudiante en arts appliqués, option animation 2D/3D, leur a emboîté le pas : car les fanfiqueurs ne se contentent pas d’écrire. Ils illustrent aussi. Et ce lien avec le dessin souligne la filiation qui existe entre fanfics et mangas. Ce n’est donc pas un hasard si nombre de fanfiqueurs ont des pseudos nippons : au Japon, même les héros de jeux vidéos ont droit à leurs fanfics, et les mangas inspirent des parodies populaires, les doujinshi, généralement dessinées par des artistes amateurs et vendues lors de conventions. Comme les mangas, les fanfictions sont des histoires à consommer. De la tradition japonaise, ils ont aussi hérité d’un genre particulier, le yaoi : une histoire relatant des relations sentimentales, voir sexuelles entre deux hommes. Voir Harry se défroquer et assister à ses ébats avec Rogue sous l’œil quasi complice de Dumbledore : voilà le type de fanfic qui ne réjouit probablement guère Mrs Rowling. Le net véhicule d’ailleurs quelques théories singulières, nées du besoin de fans purs et durs de défendre les héros de la saga poudlardienne : on y raconte, par exemple, que c’est pour réaffirmer l’hétérosexualité de Lupin, que J.K. Rowling lui aurait fait vivre une histoire d’amour avec Tonks. A la suite de son étreinte avec Sirius, dans le troisième film, il s’était en effet vu mettre en scène dans de nombreuses fics yaoi. Même, ou surtout lorsque les webcrivains se lâchent, lorsqu’ils plient leurs héros à leurs fantasmes les plus délirants ou les transportent dans des univers alternatifs, il leur arrive de mettre au monde de petits bijoux d’humour, de suspense, glamour, voire trash… Cette façon de s’approprier les héros créés par d’autres serait-elle un tremplin pour de futurs écrivains, un exercice de style qui leur permette d’apprivoiser les processus de création ? « Ado, j’ai commencé par écrire sur le modèle de mes lectures de comics, de policier ou de science fiction », confie Martin Winckler. Grand amateur de séries, le père du Docteur Sachs rappelle qu’au moins trois séries mythiques ont recruté des scénaristes parmi leurs fans : le jeune Paul Playdon avait envoyé un script aux producteurs de Mission Impossible, Brannon Braga eut autant de succès pour Star Trek et, plus récemment, le jeune avocat David Kelly a intégré l’équipe de La loi de Los Angeles avant de faire ses propres Picket Fences, Chicago Hope, The Practice, Boston Public, Boston Legal et autres Ally Mc Beal. Les fiqueurs ne semblent pourtant pas chercher explicitement à se faire repérer par les producteurs. « Ecrire reste avant tout pour eux une façon de s’exprimer, dit Winkler. La plupart sont des ados, surtout des filles. Sans doute parce le genre fanfic s’apparente à celui du journal intime : comme celui-ci, il est surtout pratiqué, avant l’âge adulte, par les filles, qui ont plus d’aptitudes à la communication verbale que les garçons du même âge. » Selon Kashiira, si les filles s’adonnent au fanfic yaoi, c’est pour contourner le récit autobiographique : « Ecrire des aventures entre garçons permet de mieux se protéger, de dire des choses plus dures parce qu’on ne s’y identifie pas. » A 26 ans, la fanfiqueuse liégeoise, n’est plus une ado. Pour cette passionnée d’écriture, les fanfics n’ont constitué qu’une étape : ses fictions sont désormais originales. Ses « Anges de la nuit » et son cycle d’ « Assombre » n’attendent plus qu’un éditeur. Mais Kashiira, elle, n’attend pas. Elle écrit, pour son plaisir. Et celui de ses weblecteurs. Isabelle Masson-Loodts pour © Victor - Supplément de l'hebdomadaire "Le Soir" n° 46 - 19 Novembre 2005 |
|
* Le manga se lève à l'ouest. Oubliez la brutalité de Goldorak ou la niaiserie de Candy. Grâce à des auteurs inventifs et des récits soignés, le manga a conquis ses lettres de noblesse. En France, ces BD d'un nouveau genre captivent les lecteurs adultes. Suivez le guide. C'est un attrape-cœur. Un album blanc aux dessins sages, que l'on s'offre ou se prête entre amis. Tiens, une BD, ça faisait longtemps... On s'y glisse un soir sans s'attendre à rien, et crac, le lendemain matin on va directement chez le libraire acheter le deuxième tome. Avec un émoi et une envie de savoir que l'on n'avait pas ressentis depuis voyons... bien longtemps. Quartier lointain, c'est l'histoire d'un quadra qui, à la suite d'une soirée bien arrosée, se réveille dans un train qui le mène dans la ville de province où il a grandi. Un peu vaseux, il se rend sur la tombe de sa mère. Et s'y endort. A son réveil, il a de nouveau 14 ans, dans les années 60, quelques mois avant que son père ne quitte le domicile conjugal. L'adulte enfermé dans un corps de collégien pourra-t-il changer le cours des choses ? Ce petit chef-d'oeuvre de finesse, qui entremêle brillamment nostalgie et fantastique, a reçu plusieurs prix, dont celui du meilleur scénario au festival d'Angoulême, en 2003. Bref, un double album hautement recommandable, dont le plus grand mérite est surtout d'avoir jeté un autre éclairage sur la BD japonaise. Ecrit et dessiné par Jirô Taniguchi, Quartier lointain est en effet un authentique manga. Autrement dit, dans sa traduction littérale, une de ces « images dérisoires » inventées dès le XIIe siècle par un moine de Kyoto, dont les Japonais sont très friands, mais que la plupart des Français ont en horreur. Un a priori ou plutôt un quiproquo, qui remonte au milieu des années 80, lorsque sont diffusées à la télévision, dans le Club Dorothée notamment, les toutes premières séries nipponnes pour enfants. Bien avant Dragon Ball ou les Pokémon, les robots grimaçants de Goldorak et les grands yeux mièvres de Candy associent pour longtemps le manga à la violence et à la niaiserie. D'étroits stéréotypes que la magie des films de Miyazaki et le récent engouement pour les albums de Taniguchi commencent tout juste à fissurer. Pour Yves Schlirf, le responsable de Kana, la branche manga de Dargaud, « la vision française est extrêmement réductrice et très vexante pour les Japonais. Cela revient à dire que les plus gros producteurs de BD au monde - 7 000 nouveaux titres et plus d'un milliard d'exemplaires vendus chaque année - ne font que de l'action ou de la violence ». La réalité est évidemment plus complexe. Au Japon, chaque catégorie de lecteurs a « son » manga. Femmes au foyer, retraités, écoliers, employés de bureau, citadins ou ruraux, amateurs de X ou fervents du jeu de go, passionnés de golf, de polar ou de gastronomie : tous les genres, même les plus surprenants, coexistent. Avec, pour se repérer, au moins trois grandes familles : le shonen (aventure, action, amitié), qui s'adresse aux jeunes gens, le shojo (intrigues amoureuses, humour et marivaudage), destiné aux jeunes filles, et le seinen, pour les adultes. Jusqu'à présent, les éditeurs français ne s'étaient intéressés qu'aux deux premières catégories. Avec succès, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, si le manga représente plus de 30 % des ventes de BD en France (l'Hexagone est le deuxième consommateur mondial de manga), c'est essentiellement grâce à des séries pour gamins ou ados, comme Dragon Ball, Yu-Gi-Oh !, Détective Conan, Les Chevaliers du zodiaque, Shaman King ou Video Girl Ai. Pourtant, le succès complètement inattendu de Quartier lointain a ouvert de nouvelles perspectives. Sans commune mesure avec les tirages du dernier Titeuf (2 millions d'exemplaires) ou du nouveau Lucky Luke (650 000 exemplaires), les ventes de ce double album (40 000 exemplaires pour chaque volume) n'ont cependant rien d'anecdotique. Du coup, beaucoup d'éditeurs se sont mis à surfer la vague Taniguchi et à publier quasi simultanément plusieurs de ses ouvrages. A la grande surprise de ce dernier d'ailleurs, mangaka discret de 58 ans, bien considéré, mais loin d'être une superstar au Japon. En France, en revanche (mais aussi en Belgique, en Espagne et en Italie), on ne le lâche plus. Il vient à nouveau de remporter une récompense au dernier festival d'Angoulême, le Prix du meilleur dessin, pour Le Sommet des dieux, une fresque du milieu de l'alpinisme. Et l'on annonce pour bientôt l'adaptation de Quartier lointain au cinéma par une production européenne. Sans compter de multiples parutions à venir, comme Icare, fruit d'une rencontre avec Moebius - l'idole de Taniguchi - un nouvel album intitulé Le Gourmet solitaire et une collaboration avec le scénariste français à la mode, Morvan. Pour les éditeurs, cet engouement a valeur de signal. La preuve que le manga adulte est enfin viable et mieux encore qu'il attire un nouveau public. A côté des fans de manga vieillissants à la recherche d'ouvrages plus matures et des amateurs de BD franco-belge tentés par l'exotisme, les librairies spécialisées voient affluer des lecteurs d'un nouveau genre. « Ce ne sont pas des habitués de la BD, affirme Laurent Muller, directeur éditorial chez Glénat. Ce sont des gens qui lisent des auteurs comme Joann Sfar ou Marjane Satrapi, s'intéressent au "roman graphique" [roman en bande dessinée, NDLR] et plus largement aux nouvelles façons de raconter des histoires. » Des amateurs de littérature et de cinéma, plutôt urbains, entre 30 et 40 ans, que le dessin en noir et blanc, l'épaisseur des albums (200 pages en moyenne) et le sens de lecture japonais (de droite à gauche) ne rebutent pas. Beaucoup de femmes, aussi. Une population d'ordinaire peu portée sur les bulles, mais qui trouve dans ce type de manga un ton et des préoccupations proches d'elle. «&nsbp;Dans Quartier lointain, L'Orme du Caucase ou L'Homme qui marche, il n'est question que du quotidien, explique Frédéric Boilet, traducteur et adaptateur de Taniguchi. De petites situations, des instants fugaces, des moments forts ou intimes qu'il a su saisir avec finesse et rendre universels. Sans doute le public féminin y a-t-il été plus réceptif. » Message reçu chez Delcourt qui mise beaucoup sur le graphisme élégant de Mari Okazaki pour toucher ce nouveau public. Casterman, l'heureux éditeur de Quartier lointain, a décidé lui aussi de jouer pleinement cette carte. Sans rêver d'une situation comparable à celle du Japon, où la majorité des lecteurs de manga sont des femmes, Frédéric Boilet, le directeur de la toute nouvelle collection Sakka, entend bien y laisser la sensibilité féminine s'exprimer. De singulières dessinatrices nipponnes, comme Kiriko Nananan (Blue), Kan Takahama (Kinderbook) et Fumiko Takano (Le Livre jaune, une petite merveille inspirée par les Thibault, de Roger Martin du Gard !) figurent ainsi dans ses toutes premières publications. Installé au Japon depuis quinze ans et lui même dessinateur, ce Vosgien se bat depuis toujours pour la reconnaissance de ce qu'il appelle « la manga ». C'est-à-dire la BD japonaise « d'auteur », le féminin - auquel il tient beaucoup - servant à marquer la différence avec des productions plus commerciales. Sa louable démarche a permis, outre la reconnaissance de Taniguchi (pour laquelle il a énormément oeuvré), la découverte par le public français d'un géant méconnu, Yoshiharu Tsuge, et de son formidable album L'Homme sans talent, qui concourait cette année pour le Grand Prix du festival d'Angoulême. Reste que l'appellation « manga d'auteur » apparaît mal adaptée à la réalité japonaise. Car, au pays du Soleil-Levant, même les mangakas les plus audacieux travaillent pour de gros éditeurs et des magazines à forts tirages où ils doivent respecter un cahier des charges très précis. De même, soumis à des impératifs alimentaires ou pour se changer les idées, les meilleurs dessinateurs japonais ne font pas, loin s'en faut, que dans le chef-d'oeuvre. Le divin Taniguchi, « auteur » par excellence sous nos latitudes, n'avoue-t-il pas « quelques séries érotiques ou d'action simpliste » et de bons vieux westerns, très influencés, paraît-il, par Blueberry... « C'est une typologie "à la française", affirme Benoît Maurer, fondateur des éditions IMHO. "BD d'auteur", ça veut dire difficile d'accès, un peu intello, alors que par essence le manga s'adresse au grand public. Chez nous, les mangas dont le graphisme sort de l'ordinaire ont tôt fait d'être étiquetés "alternatifs" ou "underground", alors qu'il n'y a pas plus accessible. » C'est donc sans a priori ni complexes qu'il faut aborder ce continent à peine émergé. Aujourd'hui, pour les esprits curieux, le choix ne manque pas. Mais malgré la multiplicité des thèmes et des styles, tous ces mangas ont une chose en commun : un soin extrême apporté à l'intrigue et à la narration. « Le meilleur compliment que l'on puisse faire à un dessinateur japonais, explique Benoît Peeters, scénariste et grand spécialiste de la BD, est de lui dire que l'on a lu son album d'une traite, qu'on n'a pas pu le lâcher. Contrairement à l'école franco-belge actuelle, faire beau ou graphique n'est pas la priorité, le dessin du manga est avant tout narratif. Réussir l'histoire prime. » Ce n'est donc pas un hasard si les meilleurs scénaristes nippons préfèrent souvent se mettre au service du manga, plus souple et lucratif, qu'à celui du septième art. Très attentifs au rythme, à l'articulation du récit, les mangakas explorent aussi dans les moindres détails la psychologie de leurs personnages. La jeune et prometteuse Kan Takahama dit ainsi consacrer énormément de temps « à attraper la réalité de chacun des personnages. Je dois les imaginer dans toutes les situations de la vie courante, être attentive à leur façon de se tenir, de marcher, de se comporter. Je visualise tous les détails. Par exemple, je sais que lorsque l'un d'entre eux dit des mensonges il a tendance à tirer plus vite sur sa cigarette. En fait, je vis en permanence avec mes prochains personnages. Dans ma tête, en ce moment, il y a une adolescente, mais aussi un homme de 40 ans. C'est sans doute à cause de lui que depuis quelque temps je m'intéresse beaucoup aux revues pornos avec des filles jeunes ! C'est un exercice périlleux... ». La schizophrénie n'est pas loin, mais c'est aussi à ce prix que l'on fait les meilleurs mangas. Comme Quartier lointain, bien sûr, mais aussi Ayako ou L'Homme sans talent, dont l'histoire vous emporte et vous lâche, bouleversé, l'oeil humide, 200 pages plus tard. Du réalisme le plus brut, le manga sait faire naître une infinie émotion. Stéphane Jarno pour © Télérama n° 2875 - 19 février 2005 |
|
* Tous fondu de Japon par Aurélia Perreau. Statistiquement : la France est le deuxième consommateur de mangas (BD japonaises) au monde après le Japon. Avec 600 000 licenciés, le judo s’affiche comme notre troisième sport national, derrière le foot et le tennis. La jeune garde ne jure que par les karaokés et troque cartes ou figurines nipponnes à la récré. Les cours de japonais croulent sous le poids d’étudiant, chaque années plus nombreux. Le futon, nec plus ultra de l’art déco, trône au milieu de nos chambres. Les sushis, qui envahissent depuis peu le rayon frais des grandes surfaces, font de l’ombre au traditionnel jambon beurre… Après l’American way of life, voici que le made in Japan envahit l’Hexagone. Culture ancestrale, vie quotidienne ou loisirs, la France règle ses pendules sur l’archipel asiatique. « Hier réservé à une élite d’intellectuels, esthètes ou artistes, le japon s’est ouvert ces dernières années au grand public français par le biais de ses loisirs », souligne monsieur Isomura, président de la Maison de la culture du Japon à Paris. D’ailleurs, les 2, 3 et 4 juillet prochains, Japan Expo, le festival des loisirs nippons, s’apprête à recevoir 40 000 visiteurs, sur 15 000 m², au CNIT, à la Défense, à Paris. Au programme : karaokés, mangas et concours de déguisement Cosplay (incarnation costumée de personnages de mangas), mais aussi démonstration de maîtres en arts martiaux, cérémonie du thé, jardin zen, conférences, expositions… « Il y a dix ans, quand nous avons lancé avec une bande de copains cette convention pour les fans de manga dans un local de 25 m², nous étions loin d’imaginer que cela prendrait une telle ampleur », se réjouit Jean-François Dufour, le président du festival. Aujourd’hui, Japan Expo, porté par 250 bénévoles, s’impose comme le plus grand festival sur le Japon en Europe. La raison d’un tel engouement ? « C’est la génération Club Dorothée qui a grandi », résume Jean-François Dufour. Fin des années 70, les séries animées nipponnes envahissent massivement le petit écran. Candy et Albator emboîtent le pas à la révolution Goldorack. Début des années 80, les Chevaliers du Zodiaques et Dragon Ball, entre autres, renforcent les rangs de ces héros qui ravissent la jeunesse. « Des personnages auxquels on pouvait enfin s’identifier », précise ce trentenaire de la cuvée Goldorack. Virginie, 27 ans, commerciale chez un distributeur d’animés (comprendre : dessins animés) japonais, fantasme depuis son plus jeune âge sur le pays du soleil : « En regardant ces dessins animés, je rêvais d’aller dans une école japonaise, de porter leurs uniformes et de vivre comme eux. Quand on aime les mangas, on aime forcément le Japon et on s’intéresse de près à sa culture. » Car les « animés », ainsi que les mangas – leur version papier – qui se vendent par millions au japon, racontent le quotidien de l’archipel : religion, traditions, société, relations humaines. « On y retrouve les valeurs fortes du pays : le respect d’autrui et des anciens, une société structurée et hiérarchisées, les codes d’honneur, une hygiène de vie. Tout cela séduit une génération déboussolée=, analyse Eric Faurie, responsable des éditions Tonkam, premier distributeur de mangas en France. « C’est aussi la cohabitation harmonieuse de l’ultra modernisme et de traditions millénaires qui est fascinante », ajoute Virignie, qui aimerait beaucoup que les Français adoptent l’incontournable rituel hanami, la célébration des arbres en fleurs. Aujourd’hui, l’univers manga a quitté le monde des enfants pour nourrir les rêves adultes : selon Nicolaï, du mensuel AnimeLand, ils sont quelques 250 000 « anime-fans » à se regrouper en conventions pro-nippones. « On chante les génériques japonais de nos séries préférées en karaoké, on découvre les dernières tendances en dessins animés, mode musique, on s’habille en personnages mangas dans les concours Cosplays » rapporte Pia, une étudiante de 20 ans. Tout comme au Japon. Et ils sont de plus en plus nombreux à vivre comme les otakus, ces adultes japonais qui s’enferment dans un monde peuplé de héros mangas, refusant une réalité qu’ils jugent trop dure. Le pays du Soleil-Levant aurait-il jeté son dévolu impérial sur la France ? « C’est plutôt dans l’autre sens que ça se passe, tient à souligner Takanori Uno, coordinateur des éditions Tonkam. Les Japonais ont été très étonnés de voir l’adoption massive de leur culture par les Français, et les producteurs de loisirs sont en train de revoir leurs stratégies marketing. » Patrick Dujardin, président de la Fédération française de bonsaï a pu constater, lui aussi, l’effervescence nipponne : « Les clubs de bonsaï ont triplé en dix ans dans l’Hexagone. Et les maîtres Japonais nous envient de voir que cet art traditionnel, délaissé par la jeunesse nipponne, remporte un tel succès en France ! » Déjà, au début du siècle, l’écrivain diplomate Paul Claudel affirmait à propos du Japon : « Il existe entre nos deux peuples une sympathie instinctive... » Une sympathie instinctive qui se transforme en amour fusionnel ! Aurélia Perreau pour © Femme Actuelle, Juin 2004. |
|
* A quoi rêve les jeunes Belles ? par Eric Loret. Bande dessinée : Ludwig II T. 1 (You Higuri / Panini) On ne peut continuer plus longtemps à se voiler la face. Il existe en vente libre des mangas où l'on peut observer des pratiques contre nature entre hommes. Ces livres dégénérés à la portée de nos enfants montrent des garçons qui se sucent les lèvres, qui s'enfoncent la langue dans la bouche, des garçons qui se postillonnent sur la glotte, qui se... Hum. Pardon. Oui, donc, le yaoi, qui, selon certains serait l'acronyme des mots japonais «Yama nashi, ochi nashi, imi nashi» c'est-à-dire en gros «pas cap' de faire une histoire», est une sous-catégorie des mangas shôjo destinés aux filles, et certains puristes le distinguent du june et du shônen-ai qui seraient moins explicites. Ludwig II, comme son nom l'indique, raconte les amours bavaroises du roi jadis débauché par Wagner, Visconti et Syberberg à des fins esthétiques. Qu'on se rassure, même si Ludwig se fait tailler une pipe par le prince Paul von Thurn und Taxis au bout de 35 pages puis sodomise Richard Hornig à la cinquantième après l'avoir menotté au radiateur, on ne voit pas ici le plus petit bout de zézette. A la place, quelques bougies, énormes et dégoulinantes, traînent au premier plan. Comme Ludwig est brun, il est le seme dans ses relations, c'est-à-dire l'actif, et tous ses amants sont blonds, car ce sont des uke, ils font la femme, comme disaient nos grands-parents, d'ailleurs ils en ont aussi les fantasmatiques cheveux longs. Tous sont évidemment des bishônen, sortes d'androgynes surfins dont le physique fait fantasmer les jeunes filles en fleur. Car le yaoi n'est pas d'abord destiné à un public gay, mais à un lectorat féminin. Ces garçons qui se paluchent entre eux sont un peu l'équivalent des scènes lesbiennes du porno macho (1). Un petit tour sur les forums Internet montre que les demoiselles apprécient particulièrement les scènes de douche et de bain, tout en trouvant dans ces livres un délicieux petit goût d'interdit ou de «perversion» soft. Le jugement moral n'est en effet jamais très loin, vu que le public de base du manga industriel brille rarement par son ouverture d'esprit. Le héros de Ludwig II passe d'ailleurs une bonne partie de son temps à s'autoflageller, car toute cette anormalité, c'est la faute à son «sang corrompu», voyez-vous. Cependant, dans l'ensemble, il est surtout présenté comme un idéaliste vierge, vivace et beau aujourd'hui une sorte d'hystérique normal, quoi. La dessinatrice You Higuri fait preuve, en outre, de scrupules historiques qui l'honorent (c'est assez pédagogique) et d'un humour pas détestable du tout, en particulier dans le making of qui clôt ce premier tome. Découvrant que Munich déborde de mugs et autres T-shirts à l'image de Ludwig, Higuri se lamente devant la tâche qui l'attend : «Aarggg, j'savais pas qu'il était aussi célèbre et proche de tous... c'est un peu comme Michael Jackson...» (1) Si le «yaoi» est populaire au Japon, on ne trouve guère en France que «New York New York» (Panini comics) et «Zetsuai 1989» chez Tonkam, qui vient en outre de lancer la collection «Boy's Love» avec les séries «Fake» et «Kizuna». Eric LORET pour © Liberation - Jeudi 08 juillet 2004 06:00 |
|
* La culture manga, nouvel art populaire ou ''japoniaiserie'' ? de Cécile Mury. Dessins animés, jeux vidéo, mode, musique, figurines en tout genre : la culture de masse japonaise fait des adeptes dans le monde entier. Dérivée de l'univers des mangas, ces BD mêlant science-fiction et romances à l'eau de rose, elle exprime d'abord la défiance de la jeunesse nippone envers le monde adulte. Avec l'exposition que lui consacre la Fondation Cartier, cette "sous-culture", revendiquée comme telle, vient rouler des mécaniques face à "l'élitisme" occidental. Pas de quoi fouetter un Pokémon... Au commencement, il y eut la télévision. Candy, Albator, Goldorak. Records d'audience - Goldorak fit même la couverture de Paris Match - et petit scandale médiatique assorti. A l'époque, vers la fin des années 70, les parents, les enseignants, la presse appelaient ça des « japoniaiseries »... Idiotes et (ou) violentes, mal fichues, abrutissantes, l'Adulte n'avait pas de mots assez durs pour rejeter ces séries animées importées du Japon. Pendant ce temps, des millions de gamins s'en délectaient. Dans les années 80-90, La Cinq de Berlusconi, TF1, AB Productions et le Club Dorothée fournirent d'autres régals nippons aux générations successives : Cat's Eyes, Cobra ou Sailor Moon, Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball et Dragon Ball Z... Et il suffit de traîner dans une cour de récré d'aujourd'hui, bourdonnante de Pokémon, Digimon et autre Sakura, pour constater que la relève est assurée. « Ces émissions ont permis de faire connaître l'animation japonaise, explique Edouard Saunal, de la boutique parisienne spécialisée Mangarake. Mais sans discernement, au point qu'on voyait s'enchaîner Les Bisounours, pour tout-petits, et Ken le survivant, une série violente, très second degré, destinée aux jeunes adultes, coupée n'importe comment et mal doublée. » Et Xavier Kawa-Topor, du festival d'animation Nouvelles images du Japon, au Forum des images, de renchérir : « La France a toujours eu du retard. Au Japon, dès les années 70, l'animation a commencé à intégrer des thèmes adolescents et adultes. Ici, on considérait encore le dessin animé comme un produit pour enfants. » Dorothée, égérie involontaire d'une nouvelle culture ? Elle fut en tout cas la marraine de nombreux « animefans », comme ils se qualifient eux-mêmes. La tranche d'âge est large, entre le trentenaire nostalgique (génération gloubiboulga ») et le gamin de 13-14 ans biberonné aux jeux vidéo. Un milieu longtemps masculin, mais qui se féminise. Guillaume Nourrisson, 20 ans, est un fan passé par toutes les étapes de la passion (fanzines, associations). Il s'occupait cette année de la communication à la convention Epita sur l'animation et le manga, organisée à l'Ecole pour l'informatique et les technologies avancées, au Kremlin-Bicêtre. Il fait partie de ce premier cercle d'aficionados, qu'il évalue à environ 50 000 personnes en France. « Mais ça influence toute la jeunesse moderne ! Par exemple, le groupe de hip-hop Saïan Supa Crew a puisé son nom dans Dragon Ball Z, et Daft Punk a demandé à Leiji Matsumoto [le créateur d'Albator, NDLR] de réaliser ses clips. » Longtemps confinés dans une marginalité suspecte, qualifiés d'otaku (en japonais, ceux qui s'enferment dans leur passion), les « passeurs » de l'animation japonaise ont peu à peu créé leurs propres réseaux, via des magazines (AnimeLand), des sites Internet. Ils forment une vraie communauté, avide d'en savoir toujours plus. « On s'est imprégnés d'une culture pleine de codes impossibles à transposer dans notre vie courante, explique Guillaume Nourrisson. Alors plutôt que de gober bêtement, on a voulu voir ce qu'il y avait derrière. » Derrière, en premier lieu, on trouve les mangas, ces bandes dessinées en noir et blanc qui explorent tous les genres : science-fiction, fantastique, policier, comique, sentimental pour filles (shoujo) ou garçons (shonen). Un monde en soi, sur lequel règne Osamu Tezuka, auteur prolifique et père de la BD japonaise. « J'aime la force de mouvement des mangas, leur découpage cinématographique, explique Jonathan, un "animefan". A côté, les BD américaines ou franco-belges ressemblent à des romans-photos ! Ce qui me fascine, aussi, c'est que la mort y est très présente, la tristesse mêlée à l'espoir et même à l'humour. Toutes choses que je ne trouvais pas ailleurs. » Pascal Lafine, lui, est allègrement passé de l'autre côté du miroir : il est désormais l'un des responsables des éditions Tonkam, qui, pour contenter leurs fans, vont jusqu'à sortir des livres à lire « à l'envers », comme au Japon, soit à partir de la dernière page et de droite à gauche, telle l'édition cartonnée de Video Girl Aï, de Masakazu Katsura, ou les tribulations fantastico-sentimentales d'un adolescent. Pour se rendre compte de l'importance du phénomène, il suffit de passer le samedi rue Keller, du côté de la Bastille, à Paris, où fleurissent les magasins spécialisés. De petits groupes papotent, s'apostrophent. On croise la jeune équipe d'Alone-Darkness Fanzine, journal fait de parodies de mangas ou de jeux vidéo. Ils ont autour de 20 ans, se sont attribué des surnoms : Benkei, Mihona, Kourai, Sano ou Yaoi... Dans la mesure de leurs moyens, ils se réservent parfois un stand dans l'une ou l'autre convention spécialisée : Cartoonist, BD Expo, qui rassemblent amateurs et professionnels. Début juin, ils avaient investi la convention Epita. Ambiance conviviale autour des produits convoités : OAV (films ou séries directement distribués en vidéo), DVD, disques, mangas, fanzines, plus les « dérivés » (figurines, posters, sous-main d'écoliers, stores décorés)... Et bien sûr, le « must » de ce genre de manifestation, les rituels festifs à la mode nippone : concours de dessin, karaokés où résonne la « J. Music » (comme japanese) ou domestic music, découverte à partir des génériques de séries. Ou encore le « Cosplay » (Costume player) : une sorte de show-concours où tout le monde se déguise, chante et danse, vêtu comme son héros (ou son héroïne) préféré. L'Internet constitue un autre point de rencontre essentiel : forums, webzines, échanges en tout genre... « Un cercle de passionnés copie et met en ligne des DVD accompagnés de la traduction, explique Edouard Saunal, ce qui permet de découvrir des séries trois à six mois seulement après les Japonais. C'est un circuit parallèle, pas un marché. Il n'y a pas d'argent en jeu. » Aujourd'hui, cette communauté jouit d'une reconnaissance que l'engouement des cinéphiles a contribué à cimenter. Ainsi le succès du génie de l'animation japonaise Hayao Miyazaki. De Princesse Mononoke au triomphal Voyage de Chihiro (Ours d'or au dernier festival de Berlin, plus d'un million d'entrées en France), il a permis au grand public occidental de dépasser certains clichés. D'autres cinéastes ont également percé, d'Isao Takahata (Le Tombeau des lucioles) à Satoshi Kon (Perfect Blue) ou Mamoru Oshii (Ghost in the shell). Le festival Nouvelles images du Japon, qui rassemblait des films reconnus ou inédits, a ainsi accueilli 22 000 spectateurs en décembre 2001. Un succès qui fait écho à leur triomphe au Japon : « Mais, là-bas, Miyazaki ou Takahata sont au centre d'une vraie pratique populaire. Cela facilite l'identification et le partage... », rappelle Xavier Kawa-Topor. Et les Japonais ne comprennent pas, dit-on, notre récente passion pour un univers créé à destination de leur marché intérieur. Les « animefans » français cultivent en effet ce paradoxe : nés avec ces images, ils leur sont aussi étrangers à jamais... De « vrais orphelins, selon Toshio Okada, ex-président du studio d'animation Gainax. Leur pays les a abandonnés. Alors ils se cherchent une identité. » Cécile MURY pour © Télérama n° 2745 - 22 août 2002 |
|
* Une jeunesse japonaise désenchantée et obsédée de technologie : Lolitas rebelles et robots machos de Jean-Philippe Pisanias. Vous vous souvenez de la doucereuse Candy, qui rêve à son petit prince des collines le soir en s'endormant ? Avez-vous imaginé que c'est, en fait, une punk avant l'heure, qui annonce l'apparition de la contre-culture féminine des années 80 au Japon ? Et Goldorak, le robot qui défendait à la même époque notre « planète bleue » ? Saviez-vous que, sans la défaite japonaise en 1945, il n'aurait probablement pas existé ? C'est ce que soutient Alessandro Gomarasca dans Poupées, robots : la culture pop japonaise, un ouvrage roboratif dans lequel il analyse culture de fille (poupées) et culture de garçon (robots). Par galanterie, débutons par les fifilles. Enfin, « fifilles », façon de parler. Car elle a beau être kawai (« mignonne ») avec ses rubans dans les cheveux et ses colliers de perles, la shoujo (« nymphette ») ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est, au minimum, une effrontée (Candy), au pire, une guerrière (Sailor Moon). « En Occident, les combattantes issues de la culture de masse ne sont presque jamais des femmes-enfants, explique Alessandro Gomarasca. Lara Croft ou l'héroïne d'Alien sont en réalité des mâles hypervirils dans des corps de femmes gonflés par la silicone ou le body-building. Au Japon, un personnage comme Sailor Moon, créé par une femme, combine innocence et agressivité, séduction et instinct guerrier. Elle met en scène la féminité et la soif de rébellion des jeunes Japonaises. » C'est dans les années 60 qu'apparaissent les premiers shoujo manga, les BD pour filles. Tezuka Osamu, le père de la bande dessinée nippone, lance la mode avec Le Prince Saphir, l'histoire d'une princesse européenne élevée comme un garçon. Le thème du travesti, qui traduit les difficultés que la fille doit surmonter pour acquérir son identité, devient récurrent. Mais la confusion des genres a ses limites : à la fin de chacune de ses histoires, l'héroïne tombe dans les bras de son prince charmant. Dans le courant des années 70, fini les happy ends systématiques. Une génération de jeunes dessinatrices utilise le manga pour répercuter leur défiance envers le monde adulte. L'idéal féminin de la « bonne épouse, bonne mère » vole en éclats. La culture de la shoujo est devenue une zone de liberté où poursuivre des intérêts et des désirs individuels, loin de la culture d'entreprise, est enfin possible », explique Alessandro Gomarasca. C'est la révolution kawai. Une révolution en rose bonbon : dans la rue, les jeunes Japonaises s'habillent comme les héroïnes de manga, chaussettes de couleur et petites barrettes en forme d'oursons dans les cheveux. Leur look très sainte-nitouche contraste, en apparence, avec la dégaine d'un Sid Vicious, mais le message nihiliste est aussi violent. « Faire semblant d'être petite, c'est une façon théâtrale de se présenter. C'est de la provocation, manière de dire "je ne veux pas être comme maman, je veux dilater au maximum mon adolescence" », traduit Gomarasca. Aujourd'hui, c'est la dernière vogue, les lolitas mixent le style petites-filles-modèles-très-comtesse-de-Ségur avec un look « gothique » à la Robert Smith, le chanteur de Cure. Par ailleurs, elles dévorent des manga yaoi qui mettent en scène des jeunes hommes androgynes et langoureux, lesquels, selon Gomarasca, « sont le reflet du désenchantement des Japonaises envers les modèles de masculinité ». Prenez ça dans les gencives, les mecs ! Certains, justement, profitent de l'appel d'air socioculturel provoqué par cette culture de filles, et développent un « complexe de lolita » en fantasmant sur des héroïnes en bikini ou, carrément, se travestissent... en fille. Mais la majorité des sarariman (employés modèles) se réfugie dans les jeux vidéo, la science-fiction et les robots. Pas qu'au Japon d'ailleurs. Chez nous aussi, Goldorak, c'est d'abord un truc de mecs. On peut avancer plusieurs interprétations psychanalytiques sauvages pour voir dans ces robots transformables une métaphore des changements physiques de l'adolescent mâle. Alessandro Gomarasca développe, lui, une explication historique, autrement plus pertinente. Reprenons Goldorak. Rappelons que ce robot géant défend la Terre de vilains extraterrestres. Il est piloté par un certain Actarus, « bon » extraterrestre élevé par un Terrien, ce qui fait de lui un des nôtres. Goldorak incarne la puissance de la technique occidentale qui a balayé Hiroshima et Nagasaki, souligne notre spécialiste italien. En effet, au lieu d'être diabolisée, la machine occidentale a été fétichisée par la culture japonaise de l'après-guerre, notamment dans les nombreux dessins animés de robots géants. » Et Actarus dans l'histoire ? Il symbolise le seishin, l'esprit, la force de la volonté typiquement japonaise qui guide, anime le robot. Autrement dit, si l'on récupère la technologie occidentale et qu'on y ajoute l'esprit japonais, alors on casse la baraque, pense le Japon de l'après-guerre. « Le robot est devenu comme une armure pour le garçon japonais, dit Alessandro Gomarasca. Mieux, pour préserver son "coeur", le corps social nippon devait absolument "se revêtir" de la technologie et de la culture matérielle occidentales. » De quoi produire une mythologie très forte. Aujourd'hui, d'ailleurs, la culture pop japonaise est souvent réduite à cette image technologique, robotisée, froide. Un Japon fantasmatique comme a été pour nous celui de la fin du XIXe siècle : « L'Occident était alors fasciné par le Japon des geishas et des samouraïs, un Extrême-Orient exotique. Mais dès la fin du XXe siècle, le Japon s'est mis à incarner, dans nos imaginaires, une société occidentale poussée à l'extrême, tant au niveau de la technologie, de l'information que de la consommation. » Pourtant, on roule toujours à vélo au Japon et les Tamagoshi, ces petits animaux virtuels qu'on glisse dans la poche, ne sont quand même pas des monstres de technologie... Une chose est sûre : seul choix alternatif à la culture pop américaine, la culture de masse nippone s'exporte. En Asie comme en Europe. On s'en méfie ou on l'adore. « La condamner en bloc ou l'approuver aveuglément en donne une représentation monolithique, donc fausse, conclut Alessandro Gomarasca. On y trouve en effet des auteurs de différentes générations, des genres nombreux (science-fiction, épouvante...), des expressions diverses (BD, ciné). Chacun de ces éléments peut être bon ou mauvais, réactionnaire ou innovant, stimulant ou lobotomisant... Jean-Philippe PISANIAS pour © Télérama n° 2745 - 22 août 2002 |
|
* Telerama et le manga : un coup d'ans l'eau, de Julien Bastide et Stéphane Ferrand Est-il un magazine ou journal n'ayant pas parlé de manga cette année ? Alors que tous les grands titres de la presse s'en font écho depuis quelques mois, avec plus ou moins de bonheur et de discernement, le magazine Télérama ouvrait à son tour ses pages, en cette fin d'été, au "phénomène manga" pour 3 articles discutables, qui nous ont inspirés une nécessaire réponse. Télérama a consacré, dans son numéro 2745 paru à la fin du mois d'août dernier, un " dossier " au manga. Penchons-nous un instant sur son titre. L'intitulé fait frémir : " La folie manga, art ou japoniaiserie ? ". D'abord, qu'est exactement cette " folie manga " ? Evoque-t-elle la bande dessinée japonaise (qui est, rappelons-le, le seul et unique sens du mot manga), les dessins animés ou la culture populaire nippone (qui ne se limite pas, loin de là, aux deux domaines précités) ? On ne le saura pas. Ce terme est une fois de plus utilisé comme mot-clé, désignant à peu près tout et n'importe quoi, pourvu que cela provienne du Japon, ait des grands yeux et un menton pointu. Au lieu de " manga ", on aurait préféré " la culture pop japonaise ", puisque c'est bien de cela, on le verra, dont il s'agit. Ensuite, la question, volontairement tape-à-l'œil, " art ou japoniaiserie ? " biaise immédiatement le débat : nous sommes sommés de choisir notre camp, de prendre position pour ou contre le manga, de manière caricaturale. En effet, seules deux alternatives semblent se présenter à nous : " le manga c'est génial " ou " le manga c'est stupide ". Or, nous savons maintenant, pour peu que l'on s'y intéresse, que la bande dessinée et les dessins animés japonais recèlent le pire comme le meilleur. Quel est donc l'intérêt de prendre parti ? Certes la formule " art ou japoniaiserie ? " a au moins le mérite de poser la question (alternative souvent refusée), mais sur des bases bien malsaines. Cette (fausse) interrogation a surtout pour fonction, semble-t-il, de faire apparaître le point de vue de Télérama sur le sujet. Qu'attendre donc, avant même d'ouvrir le magazine, d'un dossier dont l'intitulé utilise des termes approximatifs et pose une question sans nuance ? Les titres des articles qui le composent sont également très parlants : " Goldorak mon amour ", suivi de " Lolitas rebelles et robots machos " (ou comment faire tenir 4 lieux communs en 5 mots) et enfin le condescendant " Une sous culture qui s'assume ". Le premier article est pourtant un tour d'horizon un peu court mais bien renseigné du milieu des passionnés français de bande dessinée et de dessins animés japonais. Oublions le titre, substituant Goldorak à Hiroshima dans le titre du film d'Alain RESNAIS, et dont la comparaison vicieuse relève plutôt de l'effet de manche facile (du moins espérons-le…). On y trouve un rapide rappel historique de la mangaphilie en France (de l'arrivée des DA japonais à la fin des années 70 jusqu'à Pokémon), des petites interventions bien choisies (Edouard SAUNAL de la boutique Mangarake, Guillaume NOURRISSON de la convention Epita et Xavier KAWA-TOPOR du Forum des Images, caution morale indispensable) et la description fidèle d'un rassemblement de fans, un samedi après-midi rue Keller. Cécile MURY, l'auteur de l'article, souligne avec justesse que la passion des animefans français est en passe d'être légitimée par le succès public (d'estime pour l'instant) et critique des films de MIYAZAKI Hayao, et ajoute un petit lexique (Animefan, Art book, Dôjinshi…) du meilleur effet, qui répond à l'inexactitude du titre du dossier. Un bon travail, honnête. Pourquoi alors cette phrase de OKADA Toshio, l'ex-Président du studio Gainax, en forme de conclusion, qui lance à l'adresse des fans français, que " leur pays les a abandonnés, alors ils se cherchent une identité " ? Cette citation, qui apparaît à la toute fin de l'article, tombe comme un cheveu sur la soupe et donne du coup une tonalité très négative à tout ce que l'on vient de lire. En quoi s'intéresser à une autre culture serait renier la sienne ? N'est-ce pas peut-être au contraire une manière de l'affirmer, de mieux l'identifier ? Cette saine et naturelle curiosité pour d'autres cultures (des pays, hier inaccessibles, deviennent de plus en plus proches par le développement du commerce mondial et des moyens de communication) ne serait-elle pas à rapprocher de la passion qui a agité les jeunes Français pour le cinéma, la musique et le mode de vie américains au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale (certains ont comparé la " mangamania " à l'arrivée du Rock'n'roll en France : même frénésie, même incompréhension des parents) ? Rappelons pour mémoire que certains des jeunes enragés du cinéma américain (on les appellerait aujourd'hui des otaku) s'appelaient TRUFFAUT, GODARD ou ROHMER, qu'ils ont défendu dans les Cahiers du Cinéma nombre de cinéastes qui s'imposent aujourd'hui comme des évidences (HITCHCOCK, HAWKS, FORD… Qui a dit MIYAZAKI ?) et accouché d'une nouvelle manière d'envisager le cinéma, la " Politique des auteurs ", encore aujourd'hui à la base de toute critique de cinéma française… Le second papier ne peut être contredit sur le fond, car il n'est qu'une paraphrase, entrecoupée de citations, de certains chapitres de Poupées, robots : La culture pop japonaise, livre dirigé par Alessandro GOMARASCA, et publié récemment en français par les éditions Autrement. Problème : là où GOMARASCA connaît parfaitement son domaine d'étude (le manga commercial pour adolescent(e)s, des années 70 à nos jours) et livre des théories pertinentes, l'auteur de l'article, dans l'ignorance totale du sujet, semble les prendre comme argent comptant pour la totalité de la production manga. On comprend au passage ce que les théories de GOMARASCA (centrées sur les figures du robot et de la lolita) ont de séduisant pour qui n'a qu'une vision des manga et des DA nippons limitée à Candy, Sailormoon et Goldorak (rappelons que la dernière diffusion de cette série à la télévision hertzienne date de plus de 10 ans et qu'elle n'a jamais été rééditée en vidéo en France. Va-t-on enfin nous lâcher avec ce foutu robot cornu ?). Néanmoins, Jean-Philippe PISANIAS (pris de remords ?) termine son article par un paragraphe plus ambigu, ressortant un passage d'Alessandro GOMARASCA amenant à considérer que " chacun [de ces genres du manga] peut être bon ou mauvais, réactionnaire ou innovant, stimulant ou lobotomisant. ". C'est déjà mieux, mais quid d'un manga qui n'obéirait pas à ces codes ? Quid des auteurs à l'univers mature et très personnel publiés en France, comme TANIGUCHI Jiro, MATSUMOTO Taiyô ou SAKAGUCHI Hisashi ? Quid du manga alternatif, représenté depuis presque 40 ans par le magazine Garo, mais aussi par des revues comme Comic Cue ou Error ? On ne blâmera d'ailleurs pas l'auteur de l'article de ne pas connaître cette frange adulte et/ou alternative du manga, devant le peu de cas que font les éditeurs français de son existence. Mais on imagine facilement notre colère si un journaliste japonais faisait un article sur la bande dessinée française en ne s'intéressant qu'à Lanfeust de Troy ou Titeuf, ignorant jusqu'à l'existence de la " nouvelle bande dessinée française " (à laquelle Télérama a également consacré un dossier cet été, heureusement mieux renseigné que celui-ci). Certes au Japon, le manga et le DA commercial ont une visibilité et un poids économique écrasants (de la même manière qu'en France 100 exemplaires du dernier XIII se vendent pour un seul de L'ascension du Haut-Mal de David B.). Mais il convient de ne pas oublier, ou d'apprendre une bonne fois pour toutes, que, même là-bas, il existe bel et bien un dessin animé d'auteur (mais ça, tout le monde le sait depuis la canonisation médiatique de MIYAZAKI) et une bande dessinée créative, innovante, qui ne fonctionne pas sur les archétypes éculés décrits par GOMARASCA. Le dernier article nous a frappés par son ton méprisant. La journaliste se penche (pas trop bas, visiblement) sur l'exposition consacrée à MURAKAMI Takashi par la Fondation Cartier, et surtout sur Coloriage, exposition conçue par MURAKAMI dans le même lieu. Reconnaissons bien entendu que Catherine FIRMIN-DIDOT a le droit de ne pas avoir aimé cette double expo et son principe. Mais n'en est-elle pas simplement passée à côté ? Certes, l'univers coloré et volontairement " léger " de MURAKAMI peut agacer. Certes, Coloriage est un immense fourre-tout, où des répliques géantes des robots de Gundam côtoient des artistes contemporains japonais, sans réelle mise en perspective. Mais les reproches que la journaliste adresse aux deux expositions nous semblent hors-sujet. On la sent choquée par la volonté de MURAKAMI de faire cohabiter des " œuvres d'artistes " avec les " produits de la sous-culture japonaise que nous cherchons désespérément à épargner à nos enfants " (sic). MURAKAMI veut-il vraiment nous faire croire qu'une figurine Pokémon s'apparente à une œuvre d'art ? Non. L'artiste japonais n'est pas un idiot, et nous non plus ! Il semble plutôt qu'il nous invite à mieux comprendre les interdépendances entre cette culture populaire et un certain art contemporain nippon qui s'en nourrit. Par la même occasion, il abolit (temporairement) la frontière entre " Beaux-Arts " et " arts mineurs " en faisant entrer l'illustration ou la bande dessinée dans un musée (le formidable bestiaire de MIZUKI Shigeru avait fière allure ainsi présenté), pour mieux nous interpeller sur notre conception de l'art. Pourquoi pas ? Concernant l'accusation de " mièvrerie revendiquée " de l'exposition et son " refus de changer le monde ", même si elle n'est pas totalement injustifiée, il ne nous a pas semblé que les œuvres présentées se caractérisaient toutes par de " l'infantilisme " ou de la " légèreté ". Le Shinjuku Castle, palais de carton de AIDA Makoto est conçu en référence aux habitations des SDF japonais, qui prolifèrent depuis l'éclatement de la " bulle économique ". Quant aux peintures oniriques de AOSHIMA Chiho, certes fort colorées, ne sont-elles pas hantées par des fantasmes féminins morbides ? Au-delà de ces accusations, c'est bien la remise en cause par ces expositions de " notre sacralisation de l'art " qui a choqué Catherine FIRMIN-DIDOT. Une conception de l'art bien arrêtée, qu'on est libre de ne pas partager. Pourquoi alors publier de tels articles ? Parce qu'il vient un temps où manga et animation finissent par avoir un tel retentissement que les passer sous silence, c'est risquer de ne pas être " dans l'air du temps ". Parce que lorsque la concurrence en parle, Télérama est bien obligé d'en parler, de bricoler vite fait un " dossier " sans cohérence, en prenant appui sur une actualité " chaude " (le livre de GOMARASCA, l'exposition MURAKAMI) avec une bonne image en couverture histoire de frapper fort. Du coup, l'intention manquant d'honnêteté, les articles manquent de professionnalisme et de connaissances. La culture (les cultures devrions-nous dire, le terme s'accommodant mal du singulier) vit, avance, progresse, dans les voies qu'elle désire explorer, selon les attentes des publics, mais surtout, envers et contre l'avis de ceux qui n'ont qu'une seule obsession, la fixer, la cristalliser, pour mieux la posséder et s'en gargariser. Toute culture ne doit ainsi se regarder qu'avec humilité, aux antipodes des parti pris de ce dossier mal foutu, à la limite de la malhonnêteté, en un mot, indigne de Télérama. Julien BASTIDE et Stéphane FERRAND pour © Animeland 2001 |